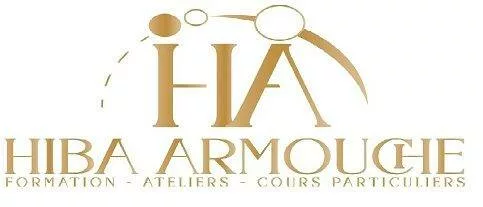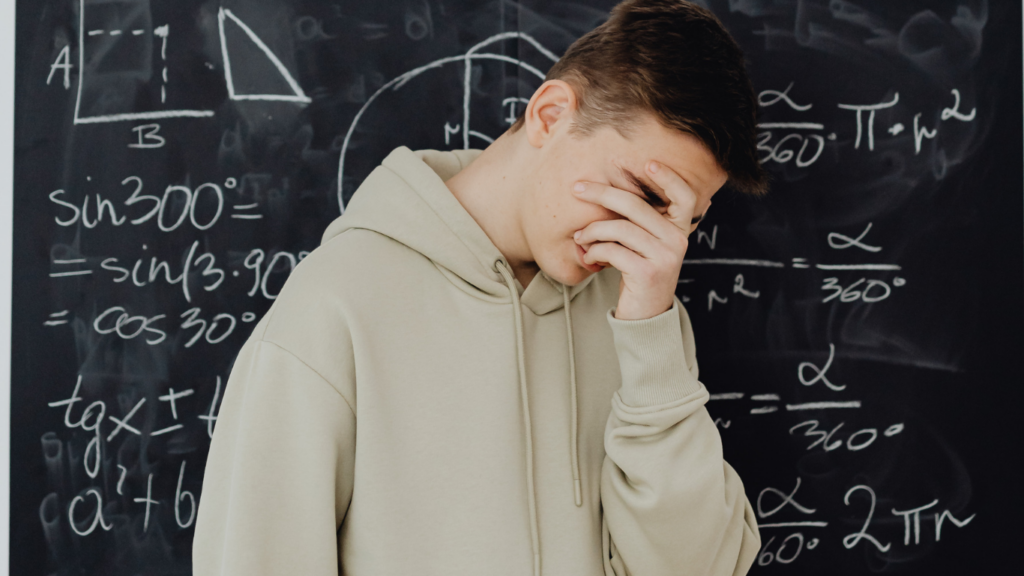
Introduction
Les mathématiques, souvent perçues comme une science rigoureuse, suscitent des réactions variées, allant du désintérêt à l’angoisse. En effet, ce phénomène, connu sous le le terme d’anxiété mathématique, toucherait un grand nombre d’élèves mais également d’adultes dans le monde entier. Or, l’anxiété mathématique n’est pas seulement une aversion pour les chiffres. En fait, l’anxiété mathématique provoque également chez l’élève ou l’adulte des sentiments de tension, d’inquiétude et de peur dans des situations en lien avec des calculs ou la résolution de problèmes mathématiques
C’est, en premier lieu, le concept même d’anxiété qui sera développé dans cet article. Tout d’abord, nous définirons de l’anxiété nous passons ensuite à l’anxiété mathématique que nous définirons ses manifestations, les outils de mesure et les recherches à son origine. Comprendre l’anxiété mathématique, c’est aussi reconnaître ceux qui souffrent de ce malaise pour créer des enjeux d’intervention qui favoriseront une relation plus apaisée et constructive avec cette discipline nécessaire changera tout.
Anxiété générale : Définition
L’anxiété, du latin « anxietas » signifiant inquiétude, est une appréhension psychologique face à l’avenir (Belzung, 2007). En effet, cette émotion négative secondaire est influencée par la culture et comporte plusieurs facteurs. Tout d’abord, elle comprend la perception d’un danger imminent, suivie d’une attente anxieuse et d’un sentiment d’impuissance (Pichot, 1987). Contrairement à la peur, qui se déclenche face à un objet réel, l’anxiété cible des dangers potentiels ou incertains. Ainsi, elle se manifeste comme une peur anticipée, comportant deux composantes: affective et cognitive (Belzung, 2007). De ce fait, si l’anxiété est une réaction normale face au stress, elle devient problématique si elle est excessive. En somme, il est important de reconnaître les nuances de l’anxiété pour en évaluer les conséquences sur le bien-être psychologique des individus.
Anxiété générale : Manifestations
On observe plusieurs manifestations possibles de l’anxiété : Des réactions physiologiques, telles l’accélération cardiaque ou l’état d’hypervigilance, mais aussi des aspects cognitifs comme les pensées négatives et des comportements d’évitement (Belzung, 2007). C’est justement ces types de réactions que l’on observe chez les personnes souffrant d’anxiété mathématique dans des situations en lien avec les mathématiques. Le traitement de la situation, perçue comme menaçante — une perception subjective —provoque un état d’incertitude et incite à la mise en oeuvre des stratégies pour atteindre ses objectifs et tenter de réduire son anxiété. Ainsi, le corps se prépare à une réaction de « combat ou fuite ». On soulignera que l’attitude adoptée par une personne à l’égard d’une situation générant une anxiété peut peser de façon significative sur sa performance (Maloney, Sattizahn et Beilock, 2014). Dans la section suivante, nous nous intéresserons précisément à l’effet de l’anxiété sur l’un des composants cognitifs centraux de l’apprentissage : la mémoire de travail.
Mémoire de travail : Un système cognitif clé
Un système cognitif fondamental de stockage et de traitement temporaire de l’information est la mémoire de travail (MDT). Plus précisément, le sujet dispose d’un espace mental où il stocke, maintient et manipule les informations qui lui sont présentées. Ceci s’avère particulièrement important dans des tâches cognitives complexes telles que la résolution de problèmes, la compréhension du langage et le raisonnement (Ribaupierre, 2016).
Anxiété et mémoire de travail: « effectiveness » et « efficiency »
La théorie du contrôle attentionnel, élaborée par Eysenck et al. (2007), propose une explicitation des effets de l’anxiété sur les activités cognitives sollicitant attention et mémoire de travail. Plus précisément, ce modèle permet d’opposer les deux dimensions de la performance : l’«effectiveness » (la qualité du traitement ou l’exactitude des réponses) et l’«efficiency » (les ressources cognitives mobilisées et la vitesse de traitement), (Eysenck, Derakshan, Santos & Calvo, 2007).
Anxiété et allocation de l’attention
Face à une situation perçue comme menaçante, le fonctionnement de la mémoire de travail est soumis à l’influence conjointe de deux systèmes attentionnels en conflit. D’une part, l’attention est mobilisée vers les stimuli pertinents pour les objectifs et attentes de la tâche telle qu’elle est conçue, c’est–à–dire les informations pertinentes à mobiliser pour résoudre le problème à traiter. D’autre part, l’attention est également mobilisée vers les stimuli environnementaux qui émergent comme des menaces perçues de façon saillante dans le champ extérieur, ou bien vers les stimuli internes tels que les ruminations et pensées négatives (Eysenck et al., 2007).
Anxiété élevée, performance cognitive et apprentissage.
Le niveau d’anxiété élevé d’une personne peut faire qu‘elle consacre une partie significative de son attention à la gestion de cette anxiété. Ainsi, la personne se concentre sur ses réactions physiologiques (palpitations, transpiration) et ses pensées négatives (peur de l’échec, sentiment d’incompétence). Évidemment, si l’on se concentre sur l’anxiété au lieu de la tâche, la performance diminue. En effet, comme l’affirme la théorie du contrôle attentionnel, certaines personnes peuvent parvenir à compenser l’effet négatif de l’anxiété sur leurs performances. Pour ce faire, elles augmentent souvent leur effort cognitif afin de maintenir un niveau de performance acceptable. La motivation à investir cet effort supplémentaire dépend de leurs attentes sur les résultats possibles (Eysenck et al., 2007).
Anxiété, doute et cognition : Une Conclusion
D’une manière générale, c’est l’attention focalisée par la personne sur ses émotions anxieuses et son doute quant à ses capacités qui perturbe le bon fonctionnement cognitif et entrave l’apprentissage (Eysenck et al., 2007). Comme l’affirment Lafortune et Sain-Pierre (1994), « La personne croit alors qu’elle ne peut plus travailler parce qu’elle ne peut plus penser. En réalité, c’est l’inverse, elle ne peut plus penser parce qu’elle a cessé de réfléchir, d’étudier et surtout, de faire appel à son processus logique » (Lafortune, 1994, cité par Lafortune et Sain-Pierre, 1994, p. 25). Cette interaction entre l’anxiété et la mémoire de travail est particulièrement pertinente dans l’apprentissage des mathématiques, où la concentration et la manipulation d’informations en mémoire de travail sont essentielles. C’est donc tout particulièrement à l’anxiété mathématique, phénomène du quotidien de plusieurs élèves et enseignants, que nous consacrons la section suivante.
Anxiété mathématique: Définition
L’anxiété mathématique est un phénomène préoccupant qui touche de nombreux élèves et adultes, bien qu’elle ne soit pas classée comme un trouble distinct. Elle se trouve dans le cadre plus général des troubles d’anxiété qui ont un impact significatif sur les performances académiques et la confiance en soi des individus. Selon Richardson et Suinn (1972), cette anxiété se manifeste par des sentiments de tension qui entravent la manipulation des nombres, rendant les situations mathématiques particulièrement stressantes. Cemen (1987) indique que cette réaction est souvent liée à des contextes perçus comme menaçants, ce qui peut nuire à l’estime de soi. Pensez aux élèves et aux étudiants qui se sentent en échec pendant leur scolarité. S’en préoccuper pourrait aider celles et ceux qui en souffrent. Il est pertinent et sans doute souhaitable de les aider en leur proposant des stratégies d’interventions qui atténuent l’anxiété mathématique et permettent l’établissement d’un climat propice aux apprentissages. L’enjeu de la sensibilisation est ici essentiel pour le bien–être de ces personnes.
Anxiété mathématique : Manifestations
Les réactions associées à l’anxiété mathématique peuvent se manifester à travers une variété de symptômes, touchant les sphères physiologiques, psychologiques et comportementales de l’individu.
Anxiété mathématique : Symptômes physiologiques
Sur le plan physiologique, l’anxiété mathématique pourrait se manifester par l’accélération du rythme cardiaque, par une sueur excessive au niveau des mains, par des douleurs d’estomac, par de fréquentes sensations de vertige (Das et Das, 2013), sans oublier l’élévation du taux de cortisol, hormone du stress (Pletzer, Wood, Moeller, Nuerk et Kerschbaum, 2010). Notons que certaines études suggèrent même que la sécrétion de cortisol pourrait amplifier l’impact négatif de l’anxiété mathématique sur les performances cognitives. Les études en neuroimagerie ont montré que l’anticipation ou la confrontation à des tâches mathématiques chez les personnes anxieuses peut activer des zones cérébrales (régions neurales) associées à l’expérience de la douleur physique ou au rejet social (Lyons et Beilock, 2012a). De plus, l’anxiété mathématique peut se traduire par une diminution de l’activité dans les régions du cerveau impliquées dans le traitement numérique et le raisonnement mathématique, combinée à une hyperactivité des régions associées à la réponse de peur acquise (Young, Wu et Menon, 2012).
Anxiété mathématique : Symptômes psychologiques
Les symptômes psychologiques de l’anxiété mathématique sont également nombreux et comprennent des difficultés de concentration, un sentiment d’impuissance face aux problèmes, des inquiétudes persistantes concernant la performance, un sentiment de gêne ou de honte lié aux erreurs, de la nervosité, de l’appréhension face aux tâches mathématiques, une prédominance de pensées négatives et catastrophistes (Das et Das, 2013), des blocages mentaux soudains, des crises de panique (Gattuso et al., 1989), la peur d’apparaître stupide aux yeux des autres, et une baisse significative de l’estime de soi (Whyte et Anthony, 2012).
Anxiété mathématique : Symptômes comportementaux
Enfin, les symptômes comportementaux se manifestent souvent par une tendance à éviter activement les cours de mathématiques, à remettre les devoirs et les révisions à la dernière minute, et à ne pas étudier la matière de manière régulière (Das et Das, 2013). Pour certaines personnes, la simple perspective d’entrer dans une salle de classe de mathématiques ou d’ouvrir un manuel peut déclencher des émotions négatives intenses (Maloney et Beilock, 2012). Les symboles mathématiques eux-mêmes peuvent être perçus comme des menaces. Ainsi, l’exposition à des stimuli associés aux mathématiques peut créer un biais de désengagement attentionnel et comportemental, un phénomène comparable à une réaction face à un stimulus de peur conditionnée (Pizzie et Kraemer, 2017).
Anxiété mathématique : Une émotion d’accomplissement anticipatoire
L’anxiété mathématique peut ainsi être conceptualisée comme une émotion d’accomplissement spécifique, caractérisée par une crainte anticipatoire face à des situations mathématiques jugées menaçantes pour l’individu, où l’échec est anticipé et le contrôle sur le résultat perçu comme inatteignable (« …conceptualisations of anxiety in the achievement emotion literature that describe MA [Math Anxiety] as an anticipatory emotion where failure is anticipated and control over this outcome seems unachievable« , Pekrun, 2006, cité par Buckley, 2016). Cette perspective met en lumière la dimension émotionnelle et la perception de contrôle comme des éléments centraux de l’anxiété mathématique.
Anxiété mathématique: Mesures et dimensions
La mesure de l’anxiété mathématique joue un rôle crucial pour identifier les individus concernés et proposer des interventions adaptées. Plusieurs échelles, principalement des questionnaires d’auto-évaluation, existent pour évaluer ce phénomène. Cependant, il manque un consensus sur la structure interne de l’anxiété mathématique, qu’elle soit unidimensionnelle ou multidimensionnelle. Le questionnaire le plus connu et fiable, le MARS (Mathematics Anxiety Rating Scale), a été développé par Richardson et Suinn en 1972. Ce questionnaire, composé de 98 questions, évalue l’anxiété liée à la manipulation des nombres et aux concepts mathématiques, en considérant l’anxiété mathématique comme un sentiment négatif global.
Évolutions et critiques des outils d’évaluation
Le MARS, bien qu’il soit largement utilisé, fait face à des critiques concernant sa longueur et son interprétation, ainsi que sa focalisation sur l’affectif. Pour répondre à ces préoccupations, des versions plus courtes ont été développées, telles que le R-Mars, l’AMAS et le sMARS. En outre, des questionnaires adaptés à l’âge, comme le MARS-A, le MARS-E, le MASC et le MAQ, prennent en compte des éléments importants tels que l’anxiété numérique et l’anxiété face aux tests. Par ailleurs, des instruments transculturels ont également émergé pour enrichir la recherche.
Des recherches récentes explorent la multidimensionnalité de l’anxiété mathématique. Ces études distinguent clairement l’anxiété face aux tests et l’anxiété numérique, tout en mettant en lumière l’anxiété liée à l’apprentissage et à l’évaluation. En effet, elles révèlent des composantes affectives, souvent débilitantes, et cognitives, qui peuvent être motivantes. Ainsi, ces travaux suggèrent une structure hiérarchique où l’anxiété liée à l’évaluation est prédominante.
Anxiété mathématique : Conclusion
L’anxiété mathématique est un phénomène complexe qui va au-delà d’une simple aversion pour les chiffres. Elle se manifeste par des sentiments de tension et de peur face aux situations mathématiques, impactant la capacité des individus à manipuler les nombres et à résoudre des problèmes. Ses manifestations touchent divers aspects, notamment physiologiques, psychologiques et comportementaux, révélant la détresse des personnes concernées. Les recherches indiquent que cette anxiété comprend des sentiments négatifs ainsi qu’une préoccupation cognitive liée à la performance. Comprendre ce trouble est essentiel pour les éducateurs et les parents, car cela permet de déstigmatiser les difficultés rencontrées par les apprenants. De ce fait, en créant un environnement d’apprentissage positif et en mettant l’accent sur la compréhension plutôt que sur la performance, il est possible d’aider les individus à surmonter leur anxiété mathématique. L’objectif est de transformer les mathématiques en une source d’épanouissement intellectuel et de réussite.
Des articles en lien:
La motivation et l’anxiété mathématique : Une relation complexe
Références
- Belzung, C. (2007). Biologie des émotions. De Boeck & Larcier.
- Buckley, S., Reid, K., Goos, M., Lipp, O., & Thomson, S. (2016). Understanding and addressing mathematics anxiety using perspectives from education, psychology and neuroscience. Australian Council for Educational Research, 60(2), 157-170.
- Das, R., & Das, G. C. (2013). Math anxiety: the poor problem solving factors in school mathematics. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(4), 1-5.
- Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. American Psychological Association, 7(2), 336-353.
- Gattuso, L., Lacasse, R., Lemire, V., & Van der Maren, J. M. (1989). Quelques aspects sociaux et affectifs de l’enseignement des mathématiques ou le vécu des mathophobes. Revue des sciences de l’éducation, 15(2), 193-218.
- Lafortune, L., & Saint-Pierre, L. (1994). Une recherche collaborative pour traiter de la métacognition et de l’affectivité. Dans L. Lafortune et L. Saint-Pierre (dir.), Actes de colloque international 94. Enseignement supérieur : stratégie d’apprentissage appropriées (p. 23-31). Association de la recherche au collégial ARC.
- Luttenberger, S., Wimmer, S., & Paechter, M. (2018). Spotlight on math anxiety. Psychology Research and Behavior Management, 11, 311-322.
- Lyons, I. M., & Beilock, S. L. (2012a). When math hurts: Math anxiety predicts pain network activation in anticipation of doing math. Plos One, 7(10), 1-6.
- Lyons, I. M., & Beilock, S. L. (2012b). Mathematics anxiety: Separating the math from the anxiety. Cerebral Cortex, 22(2), 2102-2110.
- Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5, 520-540.
- Maloney, E. A., Sattizahn, J. R., & Beilock, S. L. (2014). Anxiety and cognition. WIREs Cognitive Science, 5, 403-411.
- Pletzer, B., Wood, G., Moeller, K., Nuerk, H. C., & Kerschbaum, H. H. (2010). Predictors of performance in a real-life statistics examination depend on the individual cortisol profile. Biol Psychol, 85(3), 410-416.
- Pizzie, R. G., & Kraemer, D. J. M. (2017). Avoiding math on a rapid timescale: Emotional responsivity and anxious attention in math anxiety. Brain and Cognition, 118, 100-107. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2017.08.004
- Pouille, J. (2017). Perceptions de soi, anxiété et réussite scolaire : l’apprentissage du langage écrit (thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, France). HAL, l’archive ouverte pluridisciplinaire. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01478329/document
- Ribaupierre, A. (2016). Mémoire de travail, développement cognitif et performances scolaires. Dans E. Tardif et P. Doudain (dir.), Neurosciences et cognition (p. 165-182). De Boeck supérieur.
- Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
- Rounds, J. B., & Hendel, D. D. (1980). Measurement and dimensionality of mathematics anxiety. Journal of Counseling Psychology, 27(2), 138-149.
- Wigfield, A., & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. Journal of Educational Psychology, 80(2), 210-216.
- Whyte, J., & Anthony, G. (2012). Math anxiety: The fear factor in the mathematics classroom. New Zealand Journal of Teacher’s Work, 9(1), 6-15.
- Young, C. B., Wu, S. S., & Menon, V. (2012). The neurodevelopmental basis of math anxiety. Psychological Science, 23(5), 492-501.