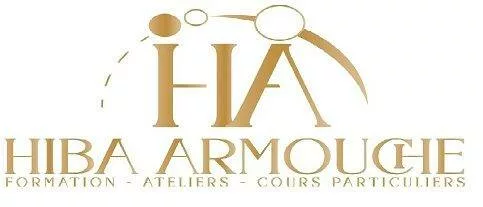Définition et nature de l’anxiété
En français, le terme «anxiété» provient du latin anxietas qui signifie la disposition d’un individu à l’inquiétude face à ce qui peut lui arriver (Belzung, 2007).
«L’anxiété est un état émotionnel, à tonalité négative, fait sur le plan phénoménologique de trois éléments fondamentaux : la perception d’un danger imminent, une attitude d’attente devant ce danger, et un sentiment de désorganisation, lié à la conscience d’une impuissance totale en face de ce danger» (Pichot, 1987, p.VII, cité par Pouille, 2017, p. 11).
Anxiété : Emotion secondaire et distinction avec la peur
Les émotions fondamentales telles que la joie ou la peur trouvent un enracinement biologique. À l’inverse, l’anxiété, elle, peut être considérée comme une émotion secondaire de nature culturelle. Par la suite, on peut tout aussi dire que peur et anxiété s’opposent. La peur apparaît face à un danger réel et précis. Tandis que l’anxiété apparaît face à un danger parcellaire. L’individu trouve difficilement ce qu’il nomme pouvoir du sujet. De ce fait l’anxiété peut être qualifiée de peur anticipée (Belzung, 2007). Elle possède une composante affective et cognitive.
L’anxiété est en fait une réaction habituelle face au danger ou face au stress. Elle permet d’alerter l’individu en jouant le rôle de signal d’alarme pour gérer la situation stressante (Belzung, 2007)
Manifestations possibles
En effet, lorsque l’individu interprète une situation comme menaçante, il va ressentir. Il ressent donc de l’incertitude et va chercher à adapter des stratégies pour atteindre son objectif. Ainsi, il cherche à réduire son anxiété. Le corps se prépare à lutter ou fuir. Dès lors, la manière dont cette personne va se comporter dans cette situation anxiogène peut avoir des conséquences sur sa performance (Maloney, Sattizahn et Beilock, 2014).
Effet de l’anxiété sur la mémoire de travail
La mémoire de travail : définition et fonctionnement
La mémoire de travail (MDT) décrit le système cognitif responsable de stockage et de traitement de l’information, qui permet à une personne de disposer d’un espace de travail pour intégrer, maintenir et manipuler les informations qui lui sont présentées (Ribaupierre, 2016).
La théorie du contrôle attentionnel : Un Cadre explicatif de l’impact de l’anxiété
La théorie du contrôle attentionnel, qui a été formulée par Eysenck et ses collaborateurs (2007), porte spécifiquement sur la tâche cognitive, celle impliquant attention et mémoire de travail, qui est au coeur de l’expérience, car elle évalue comment l’anxiété affecte la performance. En outre, ils peuvent distinguer « effectiveness » et « efficiency », l’efficacité représentant le niveau qualité ou d’exactitude des réponses tandis que l’efficience renvoie aux ressources mobilisées pour effectuer une tâche. Cela inclut aussi la vitesse de traitement (Eysenck, Derakshan, Santos & Calvo, 2007).
L’anxiété et la compétition des systèmes attentionnels dans la mémoire de travail
Face à une situation perçue comme menaçante, la mémoire de travail fait appel à deux dispositifs attentionnels. D’une part, l’attention se centre sur les objectifs de la tâche, à savoir la résolution du problème. D’autre part, elle se dirige vers les stimulus extérieurs perçus comme menaçants (Eysenck et al., 2007), mais aussi aux stimulus intérieurs comme les pensées négatives et les ruminations. C’est pourquoi les individus présentant une anxiété très élevée concentrent leur attention sur la gestion de leur anxiété. Ils se focalisent sur leurs réponses physiologiques, et sur leurs pensées négatives. Un haut niveau d’anxiété est lié à de faibles performances.
Stratégies de compensation et perturbation nognitive par l’anxiété
Il ressort de la théorie du contrôle de l’attention qu’une opportunité compensatoire serait envisageable. En effet, certains individus sont en mesure de neutraliser les effets néfastes de l’anxiété sur leurs performances en déployant plus de ressources cognitives, rendant possible le maintien de l’efficacité des tâches à réaliser. Cette volonté de faire un effort apparaît conditionnée par certaines attentes (motivation) (Eysenck et al. 2007). L’attention accordée aux émotions nuit au fonctionnement cognitif. Le doute sur ses capacités freine l’apprentissage (Eysenck et al., 2007).
« La personne croit alors qu’elle ne peut plus travailler parce qu’elle ne peut plus penser alors qu’en réalité elle ne peut plus penser parce qu’elle a cessé de réfléchir, d’étudier et surtout de mobiliser son raisonnement » (Lafortune, 1994, cité par Lafortune et Saint-Pierre, 1994, p. 25)
Conclusion
En conclusion, l’anxiété se manifeste comme un état émotionnel complexe, oscillant entre une réaction adaptative face au danger et un trouble potentiellement invalidant lorsqu’elle devient excessive ou disproportionnée. Représentant une anticipation de menaces à venir, l’anxiété est différente de la peur par son caractère flou et incertain. Son impact sur le fonctionnement cognitif, notamment la mémoire de travail, souligne la manière dont les préoccupations et les tensions peuvent détourner les ressources mentales nécessaires à la performance. Comprendre les mécanismes de l’anxiété, ses manifestations variées et la distinction entre ses formes normales et pathologiques est fondamental pour favoriser le bien-être psychologique et développer des stratégies d’intervention efficaces, qu’elles soient préventives ou curatives. En reconnaissant la nature multidimensionnelle de l’anxiété, cela rend possible d’explorer des approches plus globales permettant d’accompagner les êtres humains et de les aider à faire face à ce problème afin de retrouver un équilibre personnel et une qualité de vie satisfaisante.
Articles en lien
L’anxiété mathématique : Comprendre, identifier et agir
Références
- Belzung, C. (2007). Biologie des émotions. Bruxelles : De Boeck & Larcier.
- Eysenck, M. W., Derakshan, N. Santos, R. et Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. American Psychological Assocciation, 7 (2), 336-353.
- Lafortune, L. et Saint-Pierre, L. (1994). Une recherche collaborative pour traiter de la métacognition et de l’affectivité. Dans L. Lafortune et L. Saint-Pierre (dir.), Actes de colloque international 94. Enseignement supérieur : stratégie d’apprentissage appropriées (p. 23-31). Montréal, Canada : Association de la recherche au collégial ARC.
- Maloney, E, A,. Sattizahn, J. R. et Beilock, S. L. (2014). Anxiety and cognition. WIREs Cognitive Science 5, 403-411.
-
Pouille, J. (2017). Perceptions de soi, anxiété et réussite scolaire : l’apprentissage du langage écrit (thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, France). Récupéré de HAL, l’archive ouverte pluridisciplinaire : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01478329/document
-
Ribaupierre, A. (2016). Mémoire de travail, développent cognitive et performances scolaires. Dans E. Tardif et P. Doudain (dir.), Neurosciences et cognition (p. 165-182). Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck supérieur.
Définition et nature de l’anxiété
En français, le terme «anxiété» provient du latin anxietas qui signifie la disposition d’un individu à l’inquiétude face à ce qui peut lui arriver (Belzung, 2007).
«L’anxiété est un état émotionnel, à tonalité négative, fait sur le plan phénoménologique de trois éléments fondamentaux : la perception d’un danger imminent, une attitude d’attente devant ce danger, et un sentiment de désorganisation, lié à la conscience d’une impuissance totale en face de ce danger» (Pichot, 1987, p.VII, cité par Pouille, 2017, p. 11).
Anxiété : Emotion secondaire et distinction avec la peur
À l’inverse des émotions primaires comme la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût, qui ont un support biologique, l’anxiété constitue une émotion secondaire avec un support culturel. Ensuite, la distinction entre la peur et l’anxiété montre que la peur survient face à un objet réel et déterminé, tandis que l’anxiété se déclenche face aux situations perçues comme un danger potentiel, indéterminé et incertain devant lequel l’individu se sent impuissant. De ce fait, on peut décrire l’anxiété comme une peur anticipée qui possède une composante affective et une composante cognitive (Belzung, 2007). Par ailleurs, l’anxiété représente une réaction normale en réponse à un danger ou face à une situation stressante. En effet, elle agit comme un signal d’alarme qui permet à l’individu de faire face à la situation stressante (Belzung, 2007).
Manifestations possibles
L’anxiété peut provoquer des réactions physiologiques comme l’accélération du rythme cardiaque, l’hyper vigilance, des pensées négatives et des réactions d’évitement (Belzung, 2007). Ces réactions sont aussi présentes chez les personnes qui ont une anxiété mathématique. Quand l’individu interprète la situation comme une menace (la menace est subjective), il est en situation d’incertitude, il essaie d’adapter des stratégies pour atteindre son but et réduire l’anxiété. Ainsi, le corps se prépare à combattre ou à fuir. La manière que la personne aborde la situation anxiogène peut avoir un impact sur sa performance (Maloney, Sattizahn et Beilock, 2014).
Effet de l’anxiété sur la mémoire de travail
La mémoire de travail : définition et fonctionnement
La mémoire de travail (MDT) décrit le système cognitif responsable de stockage et de traitement de l’information, qui permet à une personne de disposer d’un espace de travail pour intégrer, maintenir et manipuler les informations qui lui sont présentées (Ribaupierre, 2016).
La théorie du contrôle attentionnel : Un Cadre explicatif de l’impact de l’anxiété
La théorie du contrôle attentionnel «Attentional Control Theory » a été développée par Eysenck et al. (2007) pour expliquer l’effet de l’anxiété sur les tâches cognitives qui nécessitent l’attention et la mémoire de travail. Ils ont fait la distinction entre effectiveness et efficiency (les termes sont en anglais). Effectivess est la qualité de traitement ou l’exactitude (précision) des réponses et efficiency concerne les ressources mobilisées et la vitesse de traitement (Eysenck, Derakshan, Santos & Calvo, 2007).
L’anxiété et la compétition des systèmes attentionnels dans la mémoire de travail
Devant une situation perçue comme menaçante, le fonctionnement de la mémoire de travail sera soumis à de deux systèmes attentionnels: 1) l’attention orientée vers les stimulus liés aux objectifs et attentes de la tâche (la résolution du problème) et 2) l’attention orientée vers les stimulus extérieurs saillants de l’environnement ressentis comme des menaces ou les stimulus intérieurs tels que les ruminations et les pensées négatives (Eysenck et al., 2007). Les individus qui ont un niveau d’anxiété élevé consacrent leur attention à la gestion de l’anxiété telles que les réactions physiologiques et les pensées négatives. Un niveau élevé d’anxiété sera associé à de faibles performances.
Stratégies de compensation et perturbation nognitive par l’anxiété
La théorie du contrôle attentionnel suggère, de plus, que certains individus peuvent compenser l’effet de l’anxiété sur leurs performances. Souvent, ils augmentent leur effort cognitif pour maintenir la performance des tâches. L’aspiration d’investir un effort dépend de leurs attentes des résultats (motivation) (Eysenck et al., 2007). Ainsi, c’est l’attention focalisée par la personne sur ses émotions et le doute de l’individu en ses capacités qui perturbent le fonctionnement cognitif et bloquent l’apprentissage (Eysenck et al., 2007).
«La personne croit alors qu’elle ne peut plus travailler parce qu’elle ne peut plus penser. En réalité, c’est l’inverse, elle ne peut plus penser parce qu’elle a cessé de réfléchir, d’étudier et surtout, de faire appel à son processus logique» (Lafortune, 1994, cité par Lafortune et Sain-Pierre, 1994, p. 25).
Conclusion
En conclusion, l’anxiété se manifeste comme un état émotionnel complexe, oscillant entre une réaction adaptative face au danger et un trouble potentiellement invalidant lorsqu’elle devient excessive ou disproportionnée. Elle définit une appréhension de menaces futures et se distingue de la peur par son caractère souvent diffus et incertain. Son impact sur le fonctionnement cognitif, notamment la mémoire de travail, souligne la manière dont les préoccupations et les tensions peuvent détourner les ressources mentales nécessaires à la performance. Comprendre les mécanismes de l’anxiété, ses manifestations variées et la distinction entre ses formes normales et pathologiques est fondamental pour favoriser le bien-être psychologique et développer des stratégies d’intervention efficaces, qu’elles soient préventives ou curatives. En reconnaissant la nature multidimensionnelle de l’anxiété, impliquant des aspects émotionnels, cognitifs et comportementaux, il devient possible d’adopter des approches holistiques pour aider les individus à mieux la gérer et à retrouver une qualité de vie optimale.
Articles en lien
L’anxiété mathématique : Comprendre, identifier et agir
Références
- Belzung, C. (2007). Biologie des émotions. Bruxelles : De Boeck & Larcier.
- Eysenck, M. W., Derakshan, N. Santos, R. et Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. American Psychological Assocciation, 7 (2), 336-353.
- Lafortune, L. et Saint-Pierre, L. (1994). Une recherche collaborative pour traiter de la métacognition et de l’affectivité. Dans L. Lafortune et L. Saint-Pierre (dir.), Actes de colloque international 94. Enseignement supérieur : stratégie d’apprentissage appropriées (p. 23-31). Montréal, Canada : Association de la recherche au collégial ARC.
- Maloney, E, A,. Sattizahn, J. R. et Beilock, S. L. (2014). Anxiety and cognition. WIREs Cognitive Science 5, 403-411.
-
Pouille, J. (2017). Perceptions de soi, anxiété et réussite scolaire : l’apprentissage du langage écrit (thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, France). Récupéré de HAL, l’archive ouverte pluridisciplinaire : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01478329/document
-
Ribaupierre, A. (2016). Mémoire de travail, développent cognitive et performances scolaires. Dans E. Tardif et P. Doudain (dir.), Neurosciences et cognition (p. 165-182). Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck supérieur.